
Les livres s’entassent dans les silos des bibliothèques, sur les étagères des libraires et des bouquinistes ou meurent sous le pilon des éditeurs. Les toiles vivent chez les antiquaires, les amateurs d’art ou finissent dans les galeries ou les musées. Les films crèvent sous la poussière des cinémathèques ou deviennent presque immortels une fois numérisés en DVD. Toutes les œuvres ont un destin, quand est-il de nos jeux, de nos consoles ? Jalousement conservés par des archivistes, des maniaques, des fétichistes ou des collectionneurs, les jeux et les consoles du passé n’ont aucun autre espace symbolique ou réel où exister en dehors de celui des joueurs. Peut-être quelques bases de données d’abandon ware sur le net, des sites pour un créer une mémoire confuse et abstraite, sans ligne, sans perspective, pas de devoir ni de travail encyclopédique, aucune construction, juste quelques liens, des structures laissées aux soins d’amateurs éclairés, pionniers par amour du jeu, amour des objets, amour du temps. Le jeu vidéo n’a pas encore d’institution réelle, d’état, il n’est pas encore inscrit comme un patrimoine, quelque chose qui ferait sens. Normal, le jeu vidéo reste une industrie, le fruit du capital et du loisir, il n’est pas un art, c’est un objet de consommation de masse voué à l’amnésie perpétuelle. Tant mieux ? Qui sait.
On sait pourtant qu’il y a une persistance et une résistance à la disparition. Que quelque part, par des initiatives personnelles, individuelles, l’histoire du jeu vidéo s’inscrit. D’abord dans nos mémoires, nos souvenirs, perpétuellement réactualisés avec la sortie de nouveaux titres venant compléter des séries initialisées sur des machines du passé. Il y a eu aussi, comme dans toutes choses produites par le capitalisme, des tentatives de retour en arrière. Des phénomènes générationnels auxquels on a vite donné un nom, un agent de classification, le retro gaming. Ecran vintage ou bien symptôme d’un nouveau rapport aux jeux vidéo et son histoire, son expérience ? Un peu des deux, c’est selon. Ce qui compte surtout c’est le type de médiation que nous entretenons avec ces jeux et ces machines. Il n’y a pas de passé en soi dans le jeu vidéo, sa seule preuve concrète d’existence tient à la technique et la fabrication même du jeu, l’évolution du gameplay, l’influence du cinéma, de la narration. L’absence d’actualité, de visibilité du réel, de références le retranche toujours ailleurs, dans un temps à lui seul et lié sa création pure. D’où la possibilité étrange de situer les jeux sur une échelle du temps qui n’appartient qu’à lui et celle de la technologie. Le jeu vidéo est le premier art de l’ère numérique dont nous écrivons à peine l’histoire, sans boussole. Un peu perdu nous avançons en tâtonnant, avec les jeux et nos expériences ludiques comme seul référant.
Comment exister dans cette histoire qui n’existe que par nous-même, nos échanges, nos rencontres, nos expériences ? Et surtout, quelle signification donner à ces objets auxquels nous donnons un passé, une valeur sentimentale ? Il y aurait-il une mélancolie possible à jouer aujourd’hui à Under Defeat, le dernier shoot de G.Rev sur Dreamcast ? Dernier jeu produit sur la dernière des machines de Sega. Les consoles et les jeux sont-ils des rêves ou des illusions qui un jour connaissent une fin inexorable ? Un peu comme une idole, une rock star, un groupe ou un auteur qui disparaît ou met fin à sa carrière, Under Defeat apparaît comme le chant du cygne d’une glorieuse carrière. La manette en main, ébloui par la beauté de ses graphismes et ses effets de fumées sidérants, épaté par la perfection de son gameplay, on ne peut s’empêcher de vivre la dernière production de G.Rev sans s’émouvoir. La Dreamcast finit en beauté, en retournant aux origines du jeu vidéo, Under Defeat s’impose comme l’un des meilleurs shoots auxquels on ait jamais joué. Simple, épuré, difficile (évidemment), entre Xevious, Tiger Heli, 1941 ou Zero Gunner, G.Rev a conçu un jeu sexy et parfait. Comme s’il voulait mener sa dernière danse avec l’éclat des derniers instants, on se laisse prendre la main la gorge nouée. Survivre au jeu ce n’est plus que toucher la perfection du doigt, c’est faire partie d’un rêve, d’un idéal, d’un projet imaginaire concrétisé dans le genre à part du shoot them up.
Que la Dreamcast finisse sur Under Defeat, c’est presque un cadeau, fait aux joueurs, à quelques initiés, à ces résistants qui par amour ont conservé leur machine sans succomber à la technologie Sony. Plus loin ce cadeau c’est celui que G.Rev fait à tout le jeu vidéo. Plus qu’aux puristes, aux collectionneurs, aux amateurs du genre, Under Defeat s’adresse à nous. C’est une déclaration d’amour, un jeu fait avec passion, un travail d’artisan que comme tout bon shoot on revisite sans cesse, qu’on apprend par cœur. Finir ainsi c’est presque dire de la Dreamcast qu’elle survivra à son décès, faire un pied de nez au next gen. Quelque chose communique, laisse une trace. Comme Ikaruga, Border Down ou Psyvariar 2, Under Defeat s’inscrit dans cet espace rare des jeux qui resteront, qui font une machine, créent des liens, inventent une histoire propre à une console et fondent une communauté de désirs. Comme au cinéma c’était constitué celle de la cinéphilie à l’aube des années 50, celle du jeu vidéo, encore éphémère, fluctuante, indéterminée sinon sans quelques pseudos castes n’ayant encore aucun cadre théorique à leur existence, un genre comme le shoot et ces productions Dreamcast permet d’imaginer l’une des branches possibles de cette communauté encore à formuler. Avec la mort de la Dreamcast et l’arrivée d’Under Defeat, on pourrait dès aujourd’hui poser les premières lignes de cette communauté, et dire qu’il ne s’agit pas que d’un groupe d’initiés, de passionnés, mais au contraire affirmer la portée universelle du jeu. Oui, Under Defeat est un genre de jeu qui ne plaît qu’à une minorité, pourtant non, le jeu de G.Rev nous concerne tous, derrière lui c’est plus que l’idée d’un type ou d’une forme de jeu qui existe, c’est tout un regard sur le jeu vidéo et son histoire. Discrètement, sans réflexivité, sans faire de post modernisme, aucune citation, pas de point clé, juste l’évidence d’un amour du jeu, de sa conception, de ses images, de son foisonnement.
Under Defeat pourrait être comme une idol. L’idol est faite pour être vénéré, elle est sacralisation absolue de la femme ; belle pour toujours, jeune à jamais, elle ne connaît pas le temps, son histoire est immédiate, instantanée, comme une étoile filante ; toujours actuelle son existence n’a de réalité que comme un fragment temporaire pris dans le tourbillon de l’image généralisée, omniprésente, la spirale des autres filles qui lui succéderont ; chaque idol est voué à être éphémère, consommé, dévoré, oublié, pourtant qui sont-elles ces filles qui occupent des mémoires, qui habitent des fantasmes, dont certains collectionnent les photos, les albums, les calendriers ? Peuvent-elles être comme ces jeux avec lesquels nous vivons et dont la si brève existence semble aller contre l’histoire ? Ces idols, stars en kit aux formes toujours sexy, aux airs perpétuellement heureux et lisses, toutes condamnées ou presque à la disparition, qui en conserve la mémoire ? Qui comme pour le jeu vidéo vient pour raconter l’histoire de leurs dernières heures, les dernières photos, la dernière vidéo ? Il y a-t-il des historiens de ces fantasmes à vendre, des théoriciens de cette jeunesse immortalisée et interchangeable ? Idem, quand Under Defeat sonne le glas d’une machine avec laquelle s’est créée un rapport, une médiation, un investissement, qui est là pour écrire son épitaphe, comment la dernière console de Sega et son dernier jeu peuvent-ils exister et disparaître dans la plus parfaite indifférence ? Les feux d’artifice bâclé d’Ubi Soft et de leur minable fantasme techno-martial incarné en Ghost Recon Advanced War Fighter, le parfait ennui d’un Oblivion et de son univers égal au plus grand des déserts du manque d’inspiration possible, les Louis Vuittonneries de Sony, la totalité des jeux en ligne ne cessant d’exterminer lentement le peu d’humanité qu’il nous reste en ruinant toute altérité réelle possible, tout ça, oui tout ça et plus encore pouvait-il caché qu’au Japon quelques individus du studio de G.Rev nous disait ce qu’est encore le jeu vidéo ? Qui en dehors de chez Nintendo, Konami, Treasure et parfois Capcom peut-il encore affirmer savoir ce qu’est un jeu vidéo, quel est son horizon ? G.Rev comme Revolution nous l’a dit, sans formule magique, sans changement hyper visible, le jeu doit avoir une âme, peu importe le genre, peu importe l’univers, il doit avoir ce supplément d’âme, ce pacte de croyance associé à une idée du jeu.
Under Defeat restera comme la fin d’une idol, adulé par une poignée de vétérans, de fidèles, oublié, ignoré par la plupart. Quelques-uns s’en souviendront, l’évoqueront bientôt avec émotion, chaleur et trémolo dans la voix. Il deviendra peut être mythique, rare, précieux, cher, recherché, comme d’autres avant lui il aura sa côte, son aura, sa réputation le précèdera. On se souviendra avoir assisté à ses obsèques. Et même si tout ça n’aura au fond pas grande importance, avoir vécu la fin d’une histoire, la mort d’une machine faite pour produire ces objets qui en jour feront partie de l’histoire de l’art, ce sera quelque chose auquel nous sommes forcé d’accorder une valeur. On dira alors, c’était le temps où…
Jérôme Dittmar







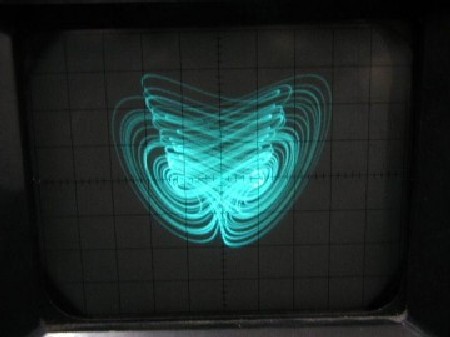


chitchat